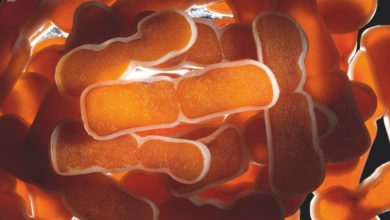« Aujourd’hui, je suis un autre cuisinier. » Le chef franco-libanais Alan Geaam, 47 ans, dit n’avoir jamais « pris autant de claques qu’en 2020 ». Autodidacte passé de la plonge au Michelin, il a perdu pied quand il a dû fermer son restaurant parisien (16e). Pas convaincu par la vente à emporter, assigné chez lui après une vie aux fourneaux, il a frôlé la dépression. Ce sont de simples galettes de blé et de maïs garnies de saveurs levantines qui lui ont redonné le sourire… Il a créé Saj (3e), son comptoir de crêpes (agneau, halloumi ou zaatar) comme celles que l’on mange dans les rues de la ville de son enfance, Tripoli. Conçu pour être éphémère, l’établissement est devenu pérenne. « Je ne voulais pas faire des burgers ou des kebabs comme tout le monde, juste apporter un peu de ma culture à Paris, explique-t‑il. On a commencé dans 10 mètres carrés et puis les voisins sont venus, les copains, tout le quartier ! Pour moi, la grande leçon du Covid, c’est que la gastronomie n’est pas que dans les assiettes haut de gamme. Nous sommes de simples cuisiniers, il faut savoir mettre sa fierté étoilée dans sa poche. »
Là, nous sommes allés vers des gens qui n’osent pas franchir la porte de nos restaurants,
Michel Troisgros
Une pause inédite dans l’histoire de la restauration
Forcés de faire une pause inédite, les restaurateurs ont dû s’adapter à tout. Fermeture et soucis d’assurances, terrasses improvisées et protocoles sanitaires. Ils ont pu bénéficier des aides de l’État et découvrir les soirées en famille. Du jamais-vu dans leur métier. Mais certains ont dû fermer. D’autres se sont jetés dans la vente à emporter. Tous ont réfléchi à leur avenir. Faut-il reprendre exactement là où les fourneaux se sont arrêtés, en mars 2020 ? Adopter la livraison ou la street food ? Ralentir le rythme ? Ils ont en tout cas dû explorer de nouveaux modèles.
La street food a été l’une de leurs planches de salut. Ils sont nombreux à être sortis de leur zone de confort pour s’essayer à d’autres types de cuisine, même opposés à la leur. À Paris, Antonin Bonnet chez Quinsou (6e) a proposé des baos coréens. Julia Sedefdjian se lance dans la cuisine du pois chiche (panisse, houmous) au Cicéron (5e). Au Dauphin (11e), Iñaki Aizpitarte a vendu des pans-bagnats, et un grand four à pizza trône désormais dans la salle de son Chateaubriand étoilé : « J’ai pris beaucoup de plaisir à faire des pizzas, je suis triste à l’idée d’arrêter, avoue-t-il. Pourquoi ne pas ouvrir une vraie pizzeria un jour, qui sait ? »
Food truck, street-food et épiceries

Au Cadoret (19e), Léa Fleuriot servira quelques assiettes à partager dès le 19 mai à la terrasse de son bistrot, après une longue fermeture : « Avec mon frère, on a décidé d’utiliser ce temps-là pour aller voir nos vignerons, s’occuper des nôtres… Mais j’ai hâte de reprendre ! Nous allons pousser notre travail encore plus loin qu’avant, notamment sur la fermentation, avec notre miso maison élaboré pendant cette pause. »
Les étoilés se sont affranchis des codes. À Marseille, le chef aux trois macarons Alexandre Mazzia a cartonné avec son food truck, Michel, et il a ouvert un bistrot (Niro) à Aix-en-Provence. En Alsace, Olivier Nasti a également adopté son food truck. Comme la famille Troisgros dans la Loire, avec un vieux fourgon Citroën baptisé Petite Cuisine. « C’est une expérience formidable, fraîche, populaire et abordable que nous n’aurions jamais faite sans ce moment qui nous a privés de relations sociales, explique Michel Troisgros. Tout le monde avait besoin de gaieté et de nouveautés et ce sont les jeunes, mes fils César et Léo et ma fille Marion, qui l’ont porté. »
Sur la place de Roanne, on patiente parfois une heure et demie devant le camion rouge. On veut absolument croquer dans leurs « pains de rue », des pains spéciaux feuilletés et garnis par exemple de bœuf snacké, de petits légumes et d’une mayonnaise maison. Les menus sont à 14,50 euros. « Nous en rêvions mais nous n’osions pas, par peur de nous dévaloriser, poursuit-il. En temps normal, on aurait dit : “Troisgros se met à faire du McDo” ! Là, nous sommes allés vers des gens qui n’osent pas franchir la porte de nos restaurants. Nous n’allons pas en rester là ! » Après une pause, le temps de la remise en route des restaurants, le camion reviendra de façon définitive.
Des terrasses et des bistrots plus populaires, de la street food haut de gamme…

Chez Pouliche, la cheffe Amandine Chaignot a été confortée dans ses choix : « cela fait des années que je pense que le modèle étoilé ne tient plus, explique-t-elle. Moi, je suis donc mon envie de spontané, de légèreté et de bienveillance que j’ai voulu dans mon resto, sans m’interdire d’ouvrir quelque chose en parallèle… »
« Moi, j’ai redécouvert mon quartier grâce à mon Arrière-Cuisine. Avant, ma clientèle venait de loin, aujourd’hui ce sont des riverains à 75 % », se réjouit David Rathgeber. Le chef de l’Assiette, bistrot canaille chic à Paris (14e), a profité de la crise pour concrétiser son projet d’épicerie bien sourcée et de street food d’inspiration voyageuse : bao de canard façon pékinoise ou burger du bougnat. Mercredi, il inaugurera une grande terrasse en service continu mais ne rouvrira pas L’Assiette avant septembre, par peur d’un été parisien désert. Il a aussi décidé de changer de rythme : « J’ai été malade, j’ai moins envie de retourner aux fourneaux à plein temps, avoue-t‑il. Mon chef Aoi Kazuaki gérera le restaurant et moi, je serai chef de cuisine, restaurateur et épicier ! »
Anciennement deux étoiles au Michelin, Alexandre Bourdas, à Honfleur, a tout changé : « Il y a une certaine rigidité protocolaire dans la haute gastronomie, j’ai toujours su que j’arrêterais, explique-t‑il. Je rêvais depuis longtemps d’une maison vivante et ouverte, avec des pâtes ou des sardines grillées. La crise a juste accéléré la décision. » En dix mois à peine, le SaQuaNa est devenu un restaurant pour tous, ouvert en continu. Il y a une boulangerie, un petit déjeuner puis un déjeuner de retour du marché à 16 euros, un salon de thé-pâtisserie, et un bar à tapas le soir. « Je suis très heureux en chef fonctionnaire ! poursuit-il. Chacun son rythme de vie : je cuisine, je sers, je parle avec les gens, je bois un verre avec les copains, je joue aux cartes avec mon père, je pêche… Je profite de la vie ! »
Une gastronomie post-Covid plus ouverte d’esprit

Du côté de Talloires, au bord du lac d’Annecy, Jean Sulpice n’a pas arrêté non plus. Avec l’objectif inverse : continuer de proposer une haute gastronomie à l’Auberge du Père Bise malgré les circonstances. Repas pour les soignants, vente à emporter, service en chambre. Sportif, le chef aux deux étoiles s’est adapté en préservant l’excellence : « J’ai adoré remplir des boîtes de livraison. J’ai fidélisé une nouvelle super clientèle, au rendez-vous chaque semaine et solidaire. » Une façon aussi de préserver le lien avec ses équipes et ses fournisseurs : « La gastronomie n’est pas morte, au contraire, elle a ouvert son esprit : nous ne craignons plus de nous aventurer ailleurs. Moi, par exemple, je vais conserver mon gastro et la vente à emporter, remplacer mon bistrot 1903 par un restaurant à la cuisine ouverte, avec mes plats signature de Val-Thorens et de l’Auberge. »
Alexandre Gauthier, deux étoiles à La Madelaine-sous-Montreuil, se veut serein : « J’ai fait des travaux dans les chambres de La Grenouillère, mais dans ma cuisine je n’ai rien changé. Je vais ouvrir un café, acheté avant la crise, qui sera un lieu plus populaire que mon restaurant, annonce-t‑il. Les gens auront envie de trouver des maisons hors norme comme ici et, avec nos jardins et nos tables espacées, nous offrons déjà ce qu’ils attendent. Nous sommes toujours là, avec l’envie intacte de faire rêver les gens. »
Charlotte Langrand